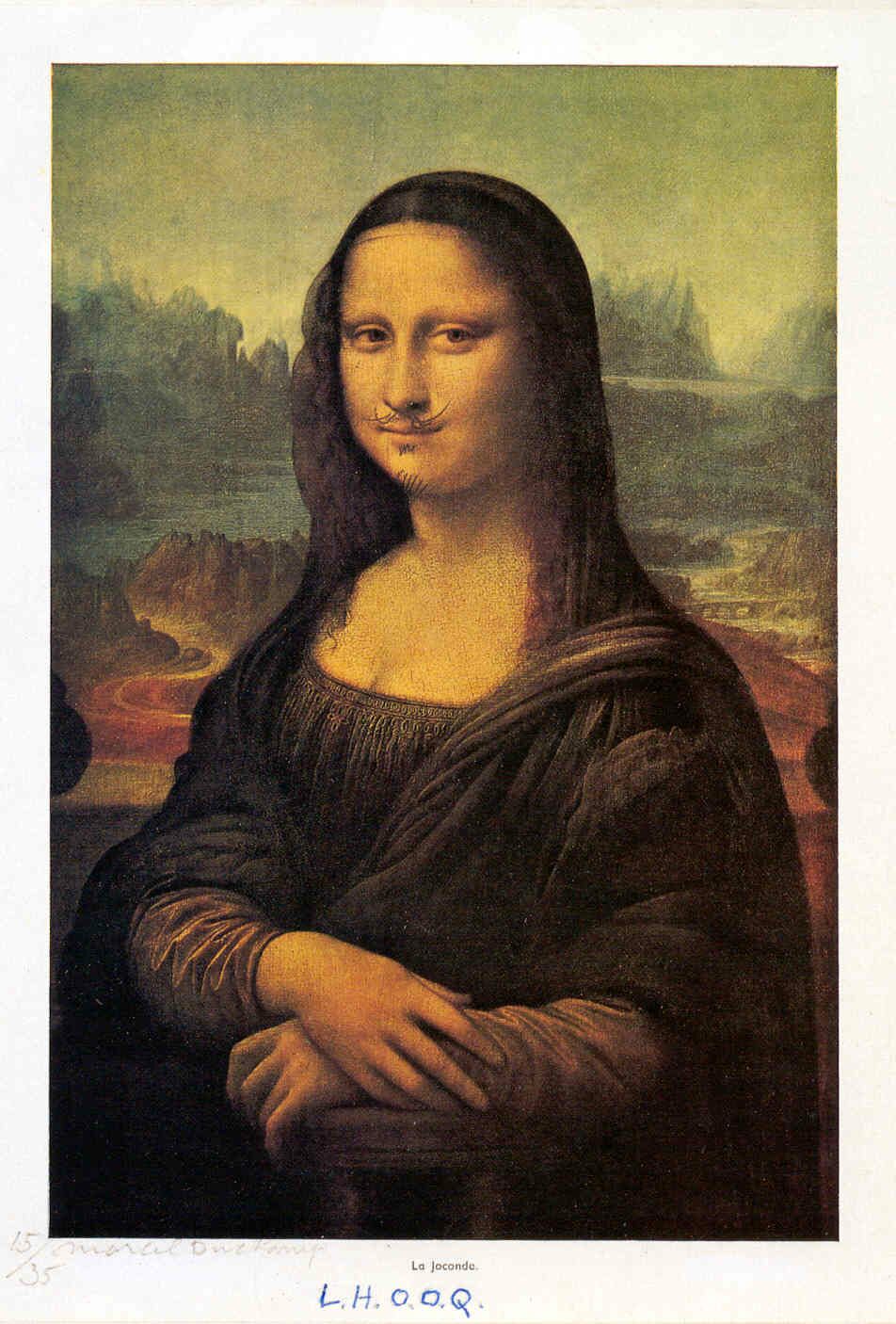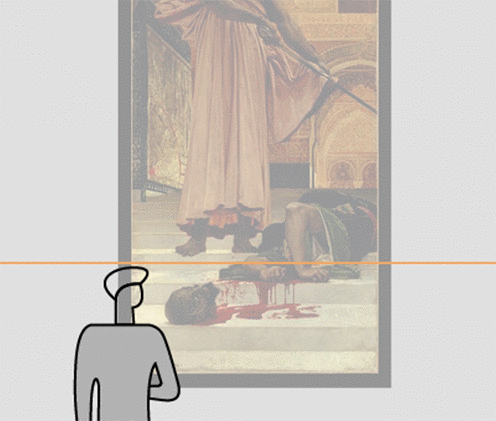Tag, flop, troop et graff – autant de signes qui représentent un milieu socio-culturel alliant des styles de graphismes et de vie. Si on cherche à en saisir les motivations et les évolutions plutôt qu’à se ranger dans le camp des censeurs ou des encenseurs, il faut les envisager comme phénomène global ayant une histoire. Ils relèvent d’un fait social, lié à l’essor des conurbations, à la mondialisation et à une forme de standardisation internationale qu’elle induit, au déploiement des moyens de communication et de transport, des migrations des personnes et de leurs habitudes, induisant une culture composite, mêlant communautarisme identitaire et métissage culturel.
Des premiers graffitis de New-York aux tags officiels du Palais de Tokyo à Paris, a-t-on affaire aux mêmes objet, projet et statut culturel ? Par une ironie de l’histoire, une clameur contre l’hégémonie de la culture wasp est devenue un signe extérieur de modernité exploité par les puissances politiques, institutionnelles ou marchandes. Une idéologie du graffiti fait office de bonne conscience pour les bombeurs et leurs défenseurs, mais est le lieu de contradictions entre les justifications et les pratiques. Elle tient dans des propositions politiques et esthétiques censées le légitimer. Il serait l’expression d’un plaisir personnel ; l’expression d’une personnalité, d’un particularisme ; l’expression de minorités opprimées ; le refus du droit de propriété, cause de l’oppression ; un apport de couleurs sur des murs lépreux ; une forme d’art subversive et nouvelle ; l’œuvre d’artistes distingués des vandales.
Nous nous limiterons à quatre exemples , pour fonder une typologie succincte par une analyse différenciée et circonstanciée de ces images, permettant de dégager quatre contradictions inhérentes à la pratique du graffiti.
Image 1, Centre Saint-Charles, Paris, 1999-2002.
Les turpitudes de Narcisse
L’appropriation d’un espace déréglée et illicite induit un hasardeux agglomérat de graphismes. Ils ne jouent pas avec la configuration de la paroi, mais en masquent les particularités. Leur entremêlement est une métaphore du refus de toute forme d’encadrement. Des couches successives apparaissent.
D’abord des tags et des dessins plus ou moins habiles (portraits, nus), au style emprunté à la b.d., sans cohérence ni continuité. Puis une surenchère, par l’ajout de pénis (près de la bouche de la femme ou en haut à gauche du dessin de la femme aux trois phallus), par la surimpression de tags.
Nous observons alors deux attitudes opposées. D’un côté un intervenant complète les premiers dessins, en explicite les sous-entendus (un projet de fellation, une éjaculation). D’un autre côté le tagueur ne respecte pas le portait, et vient donc l ‘ « arracher » . Le « territoire » mural est donc polysémique. Pour l’un, le mur est l’écran qui permet la projection compulsive de ses chimères. S’approprier un espace public est une transgression qui opère comme le processus de défoulement : forcer la censure et exposer son fantasme. Pour l’autre, le tag fait partie de cette lutte des crews pour la reconnaissance.
En effet, un tag est paradoxal : il est l’affirmation unilatérale de soi-même par une signature faisant fi des règles de sociabilité, et un appel à la reconnaissance par des groupes amis ou rivaux. Le milieu du tag a ses codes de régulation sociale, fussent-ils incompatibles avec la bonne société. D’où un atomisme social : le tag vaut pour le micro-milieu qui peut l’estimer selon des codes précis, et en identifier l’auteur, mais reste énigmatique et dégradant pour le reste de la société. Si cette atomisation se tourne contre l’ordre public, elle se retourne aussi contre le milieu même du tag puisque l’espace mural est éclaté en appropriations sauvages.
Un troisième niveau est donné par la réaction du milieu étranger à cette pratique : « C’est trop craignos les fonbous machos » et « mort aux sexistes », sentences qui sonnent comme le verdict d’un tribunal vouant aux gémonies l’usage libidinal de l’image féminine.
Cette réaction de femmes, défendant une émancipation contre un graphisme d’hommes, attaque l’idéologie machiste qui sous-tend la culture hip-hop. Elle révèle le non-dit du graffiti : le sexisme, la rivalité entre mâles pour la conquête du territoire, dont la femme est un objet. Ici la multiplication des pénis est, dans le fantasme du graffiteur, l’image d’une femelle en rut, ne pouvant assouvir sa libido que par la prolifération des pénétrations.
Ainsi la provocation des premier et second niveaux est paradoxale : loin de dénoncer l’oppression d’une minorité (ethnique, sociale) par une majorité silencieuse, elle exprime le préjugé d’un sexisme ordinaire, que ce troisième niveau ridiculise.
Un tagueur « pose » son tag « pour se faire plaisir », indifférent au déplaisir causé à autrui. En cela le bombage est paradoxal : il occasionne un communautarisme d’égoïsmes. Il procède d’une culture du narcissisme : chacun se fait plaisir, au mépris du goût des autres, cherchant une flatterie égotiste dans la reconnaissance exclusive de son groupe. Cette communauté d’individualistes est un milieu agonal : s’il y a un accord des tagueurs pour envahir un territoire, une fois marqué il devient l’objet de surcharges rivales.
Ce processus de recouvrement, inhérent à l’appropriation d’un territoire, interdit donc par principe de considérer le bombage comme une expression permanente. Le support fonctionne comme un palimpseste. Ainsi la distinction entre tagueurs vandales et graffeurs artistes ne tient pas : bon nombre de troops, de grafs, de pochoirs, manifestant des qualités plastiques ou verbales, sont « déchirés » par des tags hostiles ou des flops. Le vandalisme, comme dérobement d’un espace avant et après bombage, est donc inhérent à cette pratique.
Image 2, Barri Xino (Quartier Chinois), Barcelone, novembre 2002
La culture de la déculturation
Un portrait fut graffé et signé sur un mur et une porte d’immeuble abandonné, voué à la démolition, dans un ancien quartier populaire de Barcelone, en vue d’une reconstruction plus chic. La porte a été murée. Nous retrouvons l’indifférence par rapport au cadre et à la fonction architecturale du support. Ce portrait n’est pas inscrit dans l’encadrement de la porte, mais en déborde.
A la différence du tag, spontané et furtif, le graff est prémédité. Ce genre de dessin milite en faveur de la légitimation des graffs, le portrait étant en quelque sorte le visage d’une tristesse liée à des conditions d’existence misérables. On trouve ici la charge sociale et politique du bombage. Ce graff de circonstance exprime la tristesse de la vie et de l’habitat populaires, le regret de voir disparaître l’âme d’une ville au profit de spéculations immobilières.
Pourtant un tel graff est aussi contradictoire : si le dessin est lié à un lieu, son style est sans signe particulier, de partout et de nulle part. Peut-on le considérer comme un acte de résistance, de sauvegarde de son identité, quand ce mode d’expression est une marque d’américanisation, donc de renoncement à son identité ?
Renversement historique : le bombage, développé à New-York dans les milieux induits par les colonisations espagnoles, françaises et anglaises, envahit le Vieux Continent, comme effet retour des ex-colonisés sur les ex-colonisateurs. Le paradoxe est donc de voir comment chaque culture s’est américanisée, prenant comme medium et comme message une idéologie et une condition sociale ne correspondant pas à son histoire indigène. Ou plutôt, un tel graff révèle la part d’immigration non intégrée dans les sociétés modernes. Ainsi la « culture tag » est l’expansion du stéréotype américain dans les consciences planétaires, dans la mesure où les enfants de l’immigration étant des déracinés, ils n’ont ni les racines de leur origine ni celles de leur pays d’accueil, et suivent donc les rhizomes du multi-culturalisme américain. C’est pourquoi dans la plupart des pays les tagueurs s’expriment dans un pidgin.
Image 3, friche de la Belle de Mai, Marseille, France, mars 2003
Les Michel-Ange du macadam
On voit ici un détail d’une vaste frise, un manifeste de l’art de la rue contemporain peint sur l’enceinte d’une ancienne friche industrielle, réhabilitée en centre culturel. De ce fait, elle n’est ni marginale ni rebelle. Nous retrouvons des qualités déjà notées : un espace indifférencié, indifférent à l’identité initiale du support, où se jouxtent des graphismes variés (graff, troop), valorisant la virilité, où se juxtaposent des modes d’expression hétéroclites. Décorée par plusieurs graffeurs elle affiche des styles variés, des essais originaux.
Nous avons retenu l’extrême gauche de cette frise, qui présente une scène différente du reste dont les dessins, quoique impressionnants, restent socialement déterminés. Le graffeur a neutralisé les caractères du mur. Il a peint une scène de rue, comme si l’observateur se tenait face aux immeubles, dont l’un a toutes ses fenêtres ouvertes, chacune livrant l’intérieur d’une pièce et la diversité des vies humaines.
Ce graff est atypique par sa volonté altruiste de montrer la vie des autres. Inversant le point de vue et la relation entre le dessinateur et le spectateur, ce sont les personnages qui s’ouvrent à la rue et considèrent l’observateur. Le mur de la ville, d’un immeuble n’est plus cet espace que le bombeur s’accapare pour poser unilatéralement son imaginaire, mais devient une métonymie de l’habitat urbain et la métaphore de ce qui est à montrer dans une relation de sociabilité.
Image 4 : Centre d’information de la Jeunesse, de Puerto de la Cruz, Ténérife (Canaries), avril 2003.
Le bombeur embourgeoisé
Nous voici dans le postgraffiti. En effet, ce graff est peint sur un panneau amovible. Il fait fonction de calicot. On pourrait appeler cela un bombage lénifié : une signalétique urbaine vidée de toute force subversive. Nous avons les semblants du graff (lettrage fantaisiste, B.boys , figuration d’aérosols), mais ce n’est qu’un simulacre qui respecte les murs et la notion de cadre.
Ici le bombage n’est plus un dérèglement volontaire, mais un encadrement bien cadré qui entérine le code esthétique de la jeunesse pour qu’elle se retrouve dans une institution complice. La contre-partie est de rendre un tel code sociable en le dépouillant de sa brutalité. Le graphisme est alors ramené aux formes reçues : la bande dessinée pour la jeunesse. Un tel bombage est un compromis entre une esthétique émergeante et une institution conciliante. Ce bombage est représentatif du devenir et de la récupération en cours.
Le bombage devient un argument de marketing pour toutes sortes d’articles pour la clientèle jeune. [esp168] Aujourd’hui, si maints tagueurs sont « des jeunes des quartiers des cités des banlieues », force est de constater que d’autres sont des bourgeois dont les motivations sont hétéroclites. Le tag n’est plus le véhicule d’une pétition identitaire ; il devient un position face à l’ordre social ou moral. La contradiction culmine quand le tag se veut anarchiste en niant le droit de propriété pour légaliser le graffiti, et cherche une protection par les droits de la propriété dès qu’il devient lucratif. La confusion entre tag et logo ou label de disque est consommée quand la signature devient une marque déposée.
Entre le vandale qui « déchire » une surface et le graphiste qui planifie une frise, entre l’artiste militant et le dilettante, entre le tagueur de base condamné par la loi et le styliste réputé encensé par la loi du marché, tout diverge. Il est donc hâtif de parler de culture du tag : cette volonté d’absorber les différences et les évolutions dans une unité d’apparence correspond, selon nous, à une occultation des contradictions inhérentes à ces pratiques, tensions elles-mêmes liées à la disparition d’un modèle social et culturel unitaire.