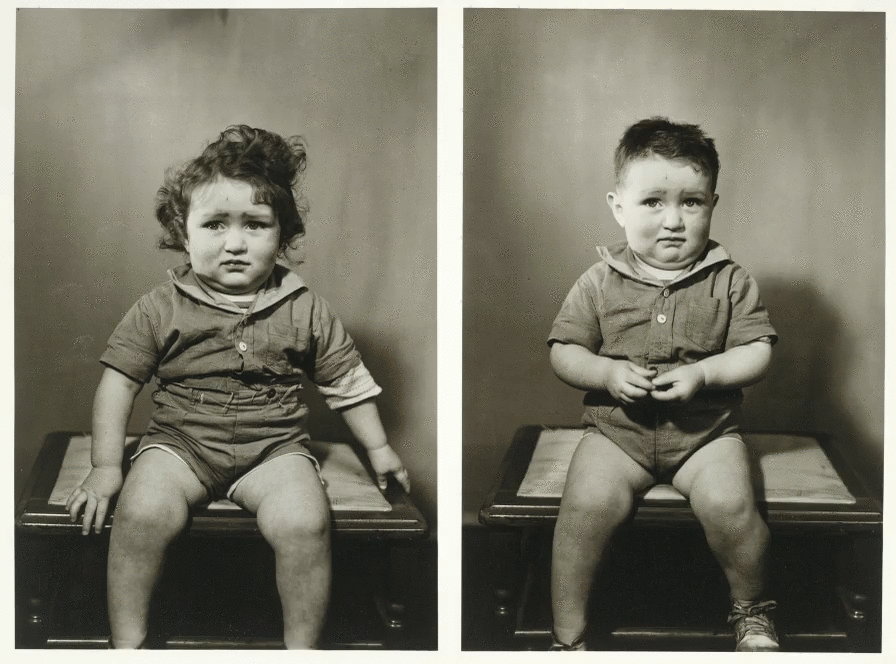Le structuralisme et la sémiologie nous ont habitués à analyser la représentation à partir d’un examen des supports médiatiques selon lequel on peut distinguer l’image et le langage, la représentation par ressemblance et la représentation par signes arbitraires. Or ce que permet la sémiotique de Peirce, au contraire, c’est de considérer les fonctions de la représentation sur un plan purement logique en évitant la réduction du support. En d’autres mots, rien n’empêche une représentation picturale ou une représentation linguistique de remplir des fonctions iconiques, indexicales, ou symboliques dans la mesure où, comme je l’ai souligné en introduction, tout ce qui est susceptible d’être présent à l’esprit doit posséder Premièreté, Deuxièmeté, et Troisièmeté. Conséquemment, la seule façon de savoir si l’on a affaire à une icône, un index ou un symbole c’est de considérer l’objet de la représentation et non son support. Par ailleurs, comme chaque chose du monde existe dans une quantité indéfinie de rapports monadiques, dyadiques, et triadiques avec soi et le monde on ne saurait faire l’inventaire de tous les objets qu’une chose, une fois sémiotisée, peut représenter.
On me fera remarquer, et avec raison, qu’une interprétation du tableau de Magritte comme indice que la sortie du musée n’est pas très loin ou encore comme symbole national ou symbole d’un musée (comme cela arrive avec certaines œuvres de Léonardo ou de Michel-Ange qui sont parfois soumises à cet usage sémiotique) n’a pratiquement rien à voir avec l’art. Bien sûr. Après tout la sémiotique, je le disais plus tôt, est une théorie de la connaissance et non une théorie de l’art
Quelques rapports sémiotiques au monde : Soit, donc, le tableau de Magritte et quelques uns de ses rapports sémiotiques au monde : le tableau peut servir à représenter une pipe ; il peut servir à représenter l’existence de ce genre d’objet qu’on appelle pipe ; il peut servir à représenter Magritte ou son style ; il peut servir à représenter des couleurs ; il peut servir à représenter une proposition négative ; il peut servir à représenter la peinture moderne ; il peut servir à représenter le musée où il est abrité ; il peut servir à représenter une exposition Magritte ; il peut servir à représenter un mode de représentation ; il peut servir à représenter la Belgique ; il peut servir à représenter le goût d’un amateur d’art ; il peut servir à évoquer des souvenirs ; il peut me servir à me représenter où je me trouve dans un musée si je me suis égaré ; etc., etc., et ce, de façon indéfinie car on ne saurait épuiser le potentiel sémiotique d’une chose du monde.
Ce qui est vrai pour le tableau dans l’ensemble l’est vrai également pour ses parties, qu’il s’agisse, par exemple, du texte ou du dessin. Dans chaque cas donc, et selon l’objet que le tableau ou une de ses parties sert à représenter, nous aurons affaire soit à une icône, à un indice, ou à un symbole.
Cela revient à dire qu’un tableau, comme celui de Magritte, peut nous faire connaître une quantité indéfinissable de choses du monde, soit à travers la quantité indéfinie de ses qualités, de ses connexions existentielles avec d’autres choses dans le monde, ou à travers la façon qu’il a de solliciter des interprétations.
Lien sémiotique à l’art : Lorsqu’un historien d’art dit connaître La trahison des images (1929) il sait en principe que l’œuvre se trouve au LACMA à Los Angeles. Sur le plan de la connaissance, cela fait partie de la signification que revêt l’œuvre aujourd’hui. Cela fait même partie de l’aura de l’œuvre d’art au sens benjaminien du terme – l’histoire de l’art s’est longtemps penchée sur la circulation des œuvres d’un collectionneur à un autre pour cette raison précisément. Or quelle différence y a-t-il entre savoir que l’œuvre se trouve au LACMA, et savoir sur quel mur elle s’y trouve, ou encore si elle est près de la sortie ? Et bien cela dépend tout simplement de l’usage sémiotique qu’on veut en faire. Du point de vue de la connaissance en général, toutes les relations d’une œuvre d’art (ou de n’importe quel objet du monde) participent à sa connaissance.
Or, comme je le laissais entendre plus tôt, il est impossible d’épuiser ces relations dont certaines toutefois sont pertinentes pour un usage et d’autres pas du tout. La question des pertinences est d’ailleurs au centre des préoccupations pragmatistes de Peirce. En ce sens, le degré d’indétermination d’un signe relève de son contexte d’usage, de ce qu’il vise à accomplir.
Fort de ce pragmatisme on peut se demander quelles qualités, quelles relations, quels rapports, c’est-à-dire en somme quelles façons de connaître l’objet, sont pertinents pour l’étude (sémiotique) de l’art aujourd’hui ? Et plus spécifiquement encore, qu’est-ce qu’interpréter une œuvre d’art aujourd’hui ?
Ce qui heurte le sens commun, voire peut-être même le sens esthétique, lorsqu’on dit qu’une partie de la signification de La trahison des images réside dans le fait que le tableau se trouve à Los Angeles c’est d’abord que l’on définit l’œuvre selon des rapports (plus ou moins) fortuits et ensuite que ceux-ci ne permettent pas d’apprécier le tableau en tant qu’œuvre d’art (si ce n’est, comme je le disais tout à l’heure, que par le détour de l’aura).
En d’autres mots, s’il s’agit là d’une qualité du tableau en tant que chose du monde à connaître, il ne s’agit pas d’une qualité de l’œuvre. Ce que recherche principalement l’interprétation de l’œuvre d’art, il me semble, ce sont plutôt des qualités, des relations conçues comme à la fois nécessaires et continues et qui se rapportent à l’œuvre comme représentation, comme signe.
L’oeuvre d’art : un symbole : Plus spécifiquement, nous pouvons dire que lire une œuvre d’art c’est chercher à la voir (à l’utiliser) comme un symbole, c’est-à-dire comme un signe authentique. C’est chercher une qualité de l’oeuvre ou une relation susceptible de déterminer une habitude de lecture de l’œuvre ; c’est voir dans l’œuvre son interprétation. Pour le dire autrement, c’est comprendre l’œuvre comme si elle était faite pour être interprétée en cherchant à y reconnaître, en son sein même, la détermination d’un mode d’usage sous l’angle d’une habitude pouvant elle-même déterminer des lectures subséquentes.
C’est bien là la définition peircéenne du symbole, dont la spécificité est d’être en fonction de son interprétation, et uniquement en fonction d’elle. En effet, écrit Peirce, un symbole est défini comme un signe qui ne devient tel qu’en vertu du fait qu’il est interprété comme tel. Et c’est pourquoi chez lui le symbole est un signe authentique alors que l’icône et l’index sont des signes dégénérés. La distinction est que si tout objet connu grâce aux fonctions iconique ou indexicale nécessite d’être interprété pour devenir icône ou index, le fait de ne pas l’être ne change rien quant à ses qualités ou quant à ses relations existentielles avec autre chose.
Alors qu’avec le symbole il en est tout autrement puisque la relation de la chose sémiotisée à son objet est inconcevable en dehors de la sémiosis. Un symbole non interprété serait alors sans relation aucune avec son objet. Et c’est pourquoi, pour revenir à La trahison des images et en ne considérant cette fois que le dessin de la pipe, on voit mal comment accepter une lecture qui se limiterait à l’effet de ressemblance et à la reconnaissance de l’objet /pipe/. On peut certes arpenter les musées dans le but de voir à quoi ressemblent certains objets, certains paysages, ou comment les gens s’habillaient à une certaine époque, etc., mais de telles interprétations (car c’en est) ne sont pas pour autant des lectures des œuvres.
La trahison des images : lecture(s)
Commençons donc par quelques évidences. A moins d’y voir, comme on l’a déjà dit, une remarque ontologique qui porte sur la distinction à apporter entre l’image d’une pipe et une pipe réelle, il ne fait aucun doute que l’étonnement ressenti la plupart du temps devant La trahison des images vient de la négation d’une relation de représentation qui apparaît, à première vue, comme une entorse à la connaissance. C’est bien un pipe que je vois et dont on semblerait dire qu’elle n’en est pas une. Rien de tout cela toutefois n’est absolument certain, puisque, comme le remarque Foucault , on pourrait croire en un certain flottement dans la référence du pronom démonstratif /Ceci/ qui sert d’index à la proposition. C’est que tout signe remplissant une fonction indexicale, comme le souligne Peirce, bien qu’il pointe en direction de l’objet, bien qu’il indique l’existence de quelque chose qui soit un objet de référence, ne dit rien à son sujet. L’index pur, explique Peirce, dénote mais ne connote pas. En outre, le /Ceci/ de « Ceci n’est pas une pipe » ne sert qu’à dénoter l’existence d’un objet indéfini dont le symbole propositionnel nous informe qu’il a la propriété d’être n’importe quoi sauf une pipe. Or, l’ambiguïté du tableau émerge lorsque le pronom /Ceci/ est référé au dessin, lequel après tout partage avec le mot /pipe/ d’être lui-aussi un interprétant de cet objet du monde qu’on appelle « pipe ».
Par interprétant, je veux dire, tout simplement, que cette chose existante qu’on peut prendre dans ses mains et avec laquelle on peut fumer du tabac peut être représentée de différentes façons, y compris directement à travers une ou plusieurs de ses qualités comme c’est le cas avec un dessin qui reproduit la forme de la chose, ou de façon générale mais indirecte par un symbole dont la tâche est de tenir lieu des différents effets, des habitudes, qui découlent de la conception qu’on a de la chose en question.
Par conséquent, le clivage des mots et des choses, de la représentation et du monde, ne saurait être absolu chez Peirce, car les mots pour ne sont pour lui que des représentations générales et accidentelles des qualités des choses, lesquelles qualités ne peuvent être connues qu’à travers la représentation iconique. C’est pourquoi Peirce dira d’ailleurs que la pensée ne saurait se passer d’icône. Ainsi, le mot /pipe/, s’il n’en est pas une dans la mesure où il en constitue le symbole, doit-il pouvoir faire émerger dans la pensée l’icône (ou l’image) d’une pipe. Peut-être serait-ce là, par ailleurs, le projet très sémiotique du tableau de Magritte : de démontrer comment le symbole requiert toujours les services de l’icône grâce à quoi il représente des qualités généralisées.
Ce que montre l’exemple du tableau, de surcroît, c’est que la proposition négative suppose la même opération que la proposition affirmative : penser à une « non-pipe » implique également l’icône d’une « pipe ». Le cas échéant l’index /Ceci/ se référerait à la proposition elle-même. L’on revient à ce que l’on disait plus tôt : un symbole suffisamment complet implique toujours un index et une icône. Le mot n’est peut-être pas la chose, mais il en suppose les qualités, comme il la suppose aussi. En ce sens, la tableau pourrait aussi bien s’intituler « Les conditions de la représentation symbolique ». Mais voilà, il s’intitule La trahison des images. Voyons cela de plus près.
Jusqu’ici ma lecture s’apparente à celle de Foucault, même si j’en tire des conclusions différentes et si les enjeux philosophiques ne sont pas les même, d’où l’économie chez moi du renvoi de l’œuvre à un quelconque calligramme imaginaire et préalable. Néanmoins, ce qui me frappe dans l’étude de Foucault, outre son incontestable ingéniosité, c’est qu’elle s’applique également à d’autres œuvres de Magritte qui, à première vue, du moins, reposent sur un dispositif identique, comme par exemple La force de l’habitude ou Ceci n’est pas une pomme. Comme si, en définitive, pour Foucault, le choix des objets auxquels Magritte faisait subir le sort du « calligramme défait » était sans importance et que seul comptait le dispositif, l’engrenage, dans lequel ils sont pris, par lequel ils sont saisis.
Et c’est en cela, principalement, que je trouve cette lecture insuffisante, entendue comme lecture d’une œuvre d’art. Car il y a d’autres significations au mot /pipe/, dont une en particulier qui s’est égarée dans les siècles à peu près partout sauf au Québec.
Une lecture liée à la sémantique :
En effet, c’est une expression bien québécoise, mais dont la source est ô combien française qui m’a mis la puce à l’oreille. Cette expression a d’ailleurs une cousine en France, il s’agit de : « conter ou raconter des pipes ». En France on dira des histoires racontées par celui qui conte des pipes » que « c’est du pipeau ». Ainsi, celui qui « conte des pipes » essaie de leurrer, de tromper.
Or, ce que démontre l’étymologie c’est que l’usage du mot /pipe/ pour désigner l’instrument du fumeur est en fait un dérivé d’un autre usage, beaucoup plus ancien celui-là, dont le champ sémantique est celui du leurre, de l’imitation, de la tromperie, ou de la tricherie.
[+]Ainsi, dans le Dictionnaire de l’ancienne langue française du IXe au XVe siècle [+] on donne le sens « tromperie » comme l’un des premiers sens du mot /pipe/, sens bien antérieur à celui qu’on utilise communément aujourd’hui. On cite ainsi Rabelais [+] chez qui on peut lire : « Nous sommes ici bien pippez a pleine pippes, mal équippez ». Ce sens a également donné les dérivés /pipeur/ (« tricheur ») et /piperie/ (« tromperie », « leurre ») qui sont toujours dans le vocabulaire actif de la langue française d’aujourd’hui.
Or voilà qui donne soudainement un nouvel air au tableau de Magritte et qui, de surcroît, le distingue assurément d’autres oeuvres, comme par exemple, Ceci n’est pas une pomme.
En effet, c’est la relation sémiotique de l’image et du texte qui se trouve changée. « Ceci », dit maintenant la proposition, « n’est pas un leurre, n’est pas une tromperie ». Or, à supposer cette fois que le pronom démonstratif se réfère au dessin de la pipe (à quoi d’autre pourrait-il se référer pour assurer le sens d’une telle proposition ?), il s’agit alors d’un retournement de la situation.
Cette fois, l’énoncé ne porte plus sur lui-même, mais bien sur l’image, et non pas pour dire qu’elle nous trompe, bien au contraire. Voilà l’image, le tableau, dévoilé – trahi – par les mots eu égard au sens premier, banal, qui frappait initialement le spectateur : « Ceci n’est pas un leurre, c’est bien une pipe » dit maintenant l’énoncé. Ou du moins, « c’est bien réellement une pipe sous un de ces aspects ».
Retour à l’iconicité :
Nous sommes ici dans le domaine de l’iconicité. Et en cela, le tableau confirme ce que nous savions aussi, mais qui avait été ébranlé par le discours de l’art moderne (« Ceci est l’image d’une pipe, non une pipe ») [+].
Il faut comprendre qu’en voyant cette pipe comme une pipe nous mettons de côté tout ce qui ne relève pas de cette identité. Ce n’est pas prendre le tableau pour un pipe, ni même l’image pour une pipe, mais c’est plutôt ne considérer que certaines de ses qualités sous l’angle d’une pure forme et ce, indépendamment de toute substance ou matière. L’icône ne distingue pas entre signe et objet, les deux se fondent dans la ressemblance, dans le partage des qualités et ce, tant qu’on les considère du seul point de vue de ces qualités.
C’est pourquoi l’icône pure n’existe pas. Exister c’est se confronter à la différence ; dans leur existence les choses sont singulières. Mais on peut malgré tout adopter une vue de l’esprit sur les choses – c’est l’iconicité – qui néglige de prendre en compte cette existence.
Aussi, reconnaître une pipe dans le tableau de Magritte c’est reconnaître certaines des qualités qui font qu’une pipe en est une, c’est donc qu’il est acceptable, du point de vue de ces qualités – et du point de vue de ces qualités seulement – de dire « C’est une pipe, et non un leurre ».
Aussi, faut-il le répéter, n’est-ce pas l’image, de toute évidence, qui est une pipe, mais bien certaines des qualités dont elle est le support et qui concernent certains aspects physiques et visibles qui appartiennent en propre à cet objet du monde. En somme, si une chose donnée se comporte comme une pipe c’est que c’en est une – du moins, du point de vue du comportement en question.
II faut bien voir que l’enjeu ici n’appartient pas à ce que j’ai appelé plus tôt « l’interprétation iconique » d’un tableau. Certes, comme je l’ai dit déjà, rien n’empêche quelqu’un d’utiliser le tableau de Magritte pour découvrir à quoi ressemble une pipe, ou encore pour prouver que ce genre d’objet a bel et bien existé dans l’histoire de l’humanité. Mais de tels usages ne considèrent que le dessin et non sa relation au texte et, surtout, sont de très peu d’intérêt pour l’esthétique dans la mesure où ils ne conduisent pas, on l’a vu, à un usage symbolique de l’œuvre d’art comme représentation.
Lire l’œuvre suppose plutôt que l’on reconnaisse son pouvoir à déterminer symboliquement, c’est-à-dire de façon authentiquement triadique, sa propre interprétation sans quoi elle ne serait pas un signe authentique.
Ainsi, l’intérêt de La trahison des images, en ce qui me concerne, ne vient pas du fait qu’elle représente cette chose du monde qu’est une pipe et permet ainsi de la connaître, ou du moins d’en connaître un certain aspect à travers une ressemblance et un token , mais bien du fait qu’elle se représente symboliquement elle-même en train de représenter et qu’elle y arrive en déterminant elle-même cette interprétation à travers le réseau sémantique archaïque attaché au mot /pipe/.
Mettre de l’avant l’intentionnalité de l’artiste risquerait fort de nous conduire à revenir à la position selon laquelle les signes sont en nous et que nous sommes leur maître. Or on l’a vu, Peirce démontre plutôt que c’est nous qui sommes dans les signes. Aussi, non seulement La trahison des images offre-t-elle très certainement l’icône d’une pipe, mais elle offre de surcroît, grâce à son texte, une représentation symbolique de sa représentation iconique et picturale d’une pipe. C’est là l’une des conséquences, un des effets, ou des interprétants, déterminés par le tableau, c’est-à-dire par le texte et par sa mise en relation avec le dessin.
Et en ce sens, La trahison des images doit être distinguée de sa version anglaise, The Treachery of Images, peinte en 1935 et qui constitue donc une œuvre dont le contenu est entièrement différent et, à mon avis, passablement moins riche que la version française étant donné l’absence du même réseau sémantique attaché au mot « pipe ». Quoi qu’il en soit cette interprétation, grâce à laquelle on arrive à une connaissance de l’œuvre par les signes, rien n’empêche ensuite de la généraliser à son tour, c’est-à-dire de l’interpréter et d’y voir, par exemple, une représentation de la peinture mimétique en général ; de cette peinture qui attire à la « pipée » les oiseaux comme le faisait Zeuxis avec ses raisins, ou encore Magritte lui-même avec ses pommes et ce, par La force de l’habitude.
Pour conclure
Je dirai pour conclure qu’il ne s’agit pas, en définitive, d’opposer différentes lectures de La trahison des images, soit d’opposer une lecture où il est question de l’image (« Ceci, cette image, n’est pas une pipe puisque c’est une image ») ; à une autre où il est question de la proposition négative et de son recours à l’iconicité (« Ceci, cette proposition, n’est pas une pipe, mais elle requiert une icône ») ; ou encore à une troisième où l’on affirme le statut et l’interprétation de l’icône (« Ceci n’est pas un leurre, c’est une pipe »).
Il ne s’agit pas de les opposer car toutes ces idées générales, ces lectures, ces habitudes d’interprétation que détermine le même tableau, portent sur des objets sémiotiques différents ou, pour le dire autrement, sur des relations sémiotiques différentes et qui sont toutes pertinentes, il me semble, pour connaître cette œuvre d’art. Et il en existe assurément plusieurs autres. Aussi est-ce là, il me semble, que se trouve la véritable force de cette œuvre, dans cette façon qu’elle a de nous faire entrevoir l’impossibilité d’épuiser, depuis le domaine même de l’art, le sens du mot connaître.