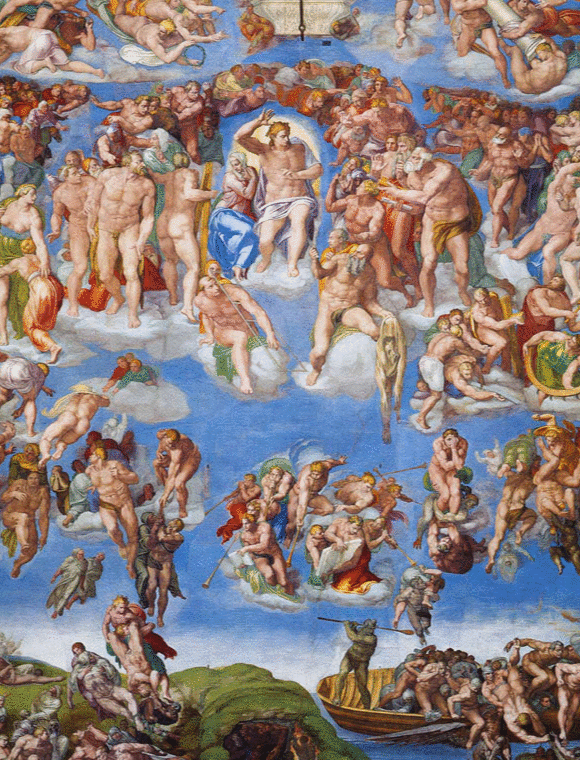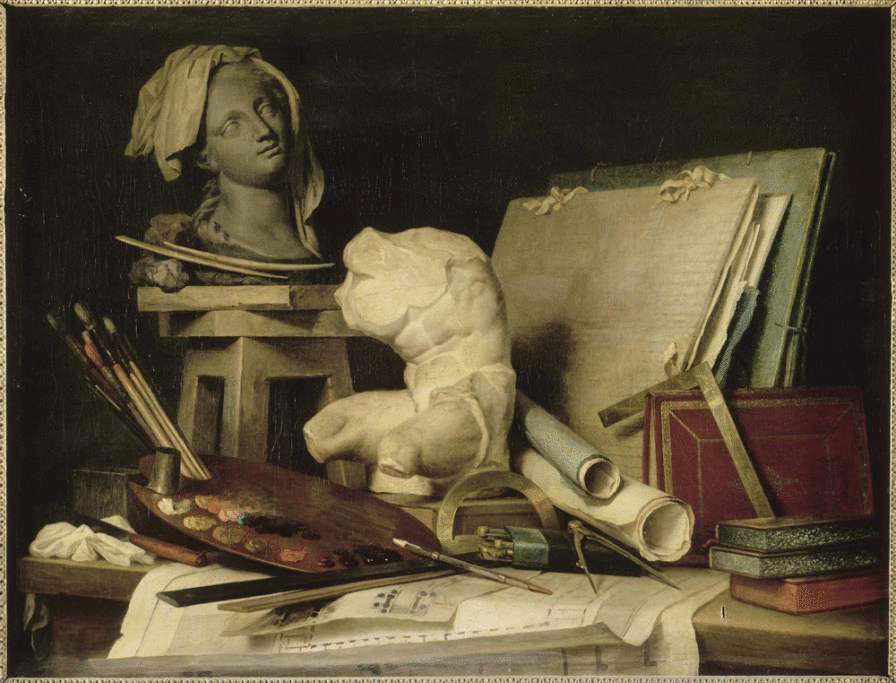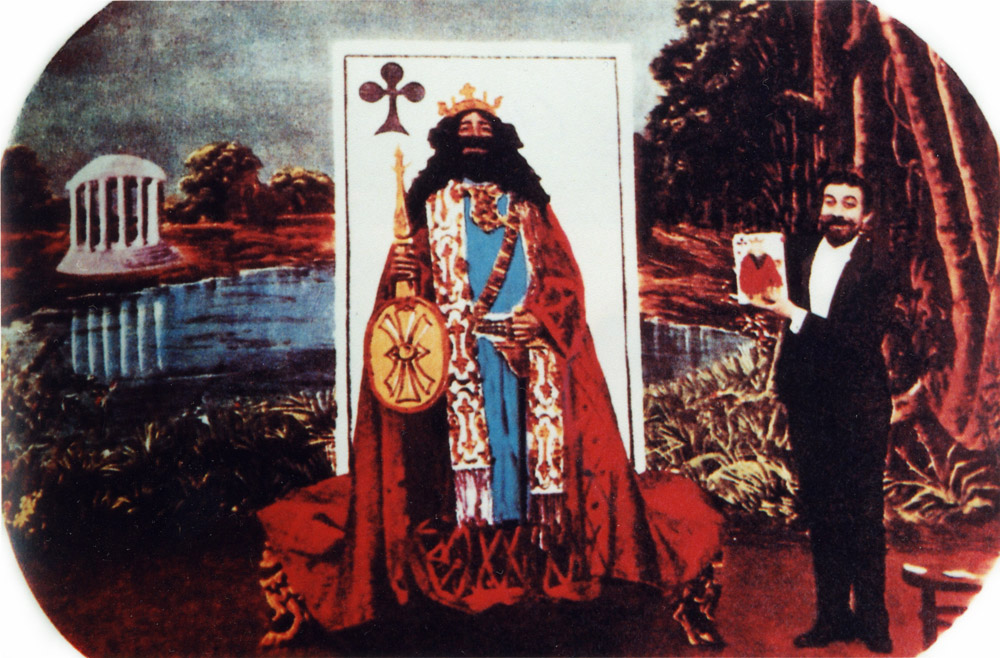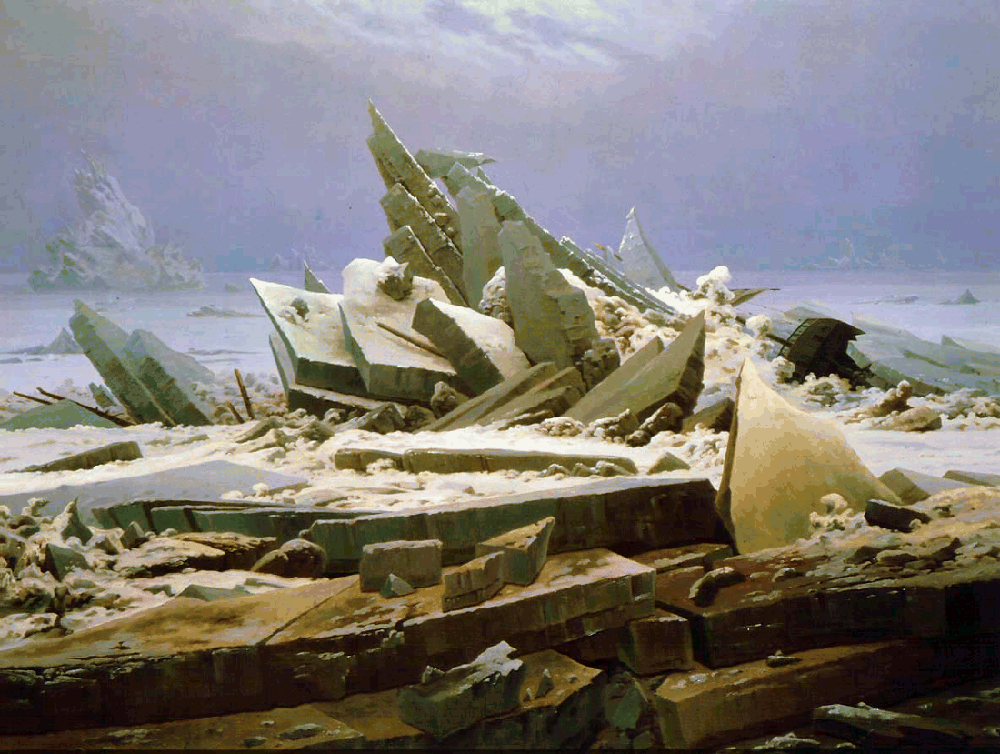On sera attentif, par-delà la forte impression produite, à l’originalité de la conception de la fresque et à un autoportrait insolite. Une description minutieuse permettra d’en dégager la spécificité et d’envisager différentes hypothèses.
En s’appuyant sur une triple recontextualisation de ce détail, dans l’héritage renaissant, dans l’ensemble de la fresque, dans la thématique poétique de Michel-Ange, on en montrera le sens et la dimension plurielle, ce qui conduira à redéfinir l’acte d’interprétation.
La fresque, réalisée de 1536 à 1541, se déploie d’un angle à l’autre du mur d’autel de la chapelle Sixtine, incorporant les corniches.
Elle substitue ainsi à la réalité architecturale la présence imminente du Jugement dernier.
Contrastant avec l’ordonnance des autres murs et des représentations antérieures, de tumultueuses psychomachies orchestrent ici l’espérance extatique des uns, l’agitation frénétique des autres, l’attente angoissée de tous, aspirés en vagues successives par la puissance solaire qui émane du Sauveur.
Ni vraiment debout ni même assis comme le veut la tradition, il appelle les élus et condamne les réprouvés dans un geste en suspens.
A ses pieds, Laurent et Barthélémy tiennent les instruments de leur martyre. Le coutelas de ce dernier est particulièrement mis en évidence.
Barthélemy n’avait jamais été placé ainsi. Innovation remarquable car le saint brandit sa propre dépouille sur laquelle on peut reconnaître l’autoportrait du peintre.
L’étrange signature presque au milieu de la fresque relève-t-elle du goût renaissant pour les allusions cryptées ?
Le visage du Christ rappelle l’Apollon du Belvédère, lui répond la peau d’un Marsyas écorché par le dieu citharède.
Simple jeu ? Non car le supplice souligne l’angoisse du verdict ultime (païen ou chrétien, Dieu seul détient le pouvoir de châtier ou sauver) et dénonce l’orgueil d’une rivalité monstrueuse (Marsyas fut puni pour avoir prétendu être meilleur musicien qu’Apollon).
Le thème de l’imitation est doublement présent dans la fresque. Barthélémy prolonge à l’horizontale le groupe des martyrs. Dominés par la croix du bon larron, ils imitent la souffrance christique. La dépouille pend verticalement à l’aplomb de la barque de Charon ; au-dessous de la dépouille, une âme se fige, entraînée vers l’Enfer, dans la pose typique de la mélancolie.
Michel-Ange souffrait de cette maladie – liée, croyait-on, au génie par les violents transports imaginatifs qu’elle suscitait.
Signant cette peau de Marsyas, le peintre dénonce cet orgueil peccamineux et refuse de rivaliser avec Dieu, seul Créateur.
Bien plus, agenouillé à ses pieds, il implore son aide. L’angle de son bras levé réplique en mineur celui de Jésus.
Or depuis Dante, l’écorchement de Marsyas symbolise l’inspiration apollinienne. Michel-Ange conçoit son art comme taille qui sculpte dans la matière inerte une vive image ; son marteau, dit-il, est guidé et forgé par le marteau divin.
Ici son bras est aimanté pour dégager la forme idéale de la peau des apparences. Le couteau salvateur libère aussi l’âme qui espère sa rédemption. Se figurer sur la dépouille, c’est implorer le Salut à l’heure du Jugement dernier. Prière muette et répétée plus bas, un ange accroupi hisse à l’aide d’une corde de rosaire deux âmes enroulées qui s’y agrippent, innovation du peintre que l’on trouve suggérée dans l’un de ses poèmes.
Voilà pourquoi le saint exhibe sa peau avec cette insistance oblative. Il doit être au plus près du Christ pour oser une noble imitation et aller jusqu’au bout d’une incertaine délivrance.
Peut-être même faut-il aller jusqu’à l’abandon du couteau levé et de l’art lui-même – question explicite à la fin de la vie du peintre.
Loin de témoigner de la prétention d’un « créateur » ou de n’être qu’un déguisement pour lettrés, silène à la manière d’un Rabelais ou d’un Erasme, l’autoportrait supplicié regarde le spectateur et l’interpelle.
Il ouvre un espace interprétatif – picturalement manifeste dans le ruban de ciel qui l’isole de la densité tumultueuse des groupes de corps – et invite à la circulation des regards dans la fresque.
L’œuvre s’ouvre alors d’interprétation en interprétation sans qu’aucune ne l’épuise, elle excède l’explicite d’une figuration.
Ainsi l’écorchement réalise, sur le plan religieux mais aussi plastique, un dénuement de soi qui est tout à la fois une ouverture, un don et un accueil. Michel-Ange n’abandonne pas cette peau dont il se défait, il la met à la disposition de qui la voit.
Ainsi en va-t-il de la fresque tout entière, composition dont le spectateur dispose dans un mimétisme du regard qui le dépouille à son tour de ses repères et de ses certitudes.